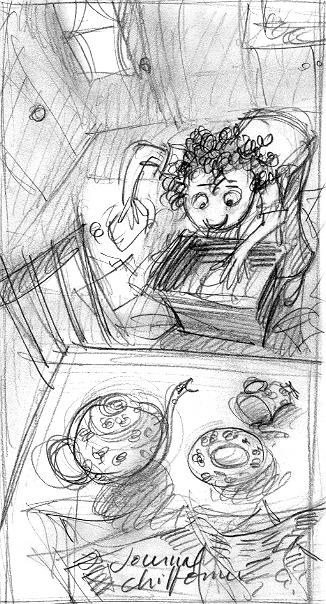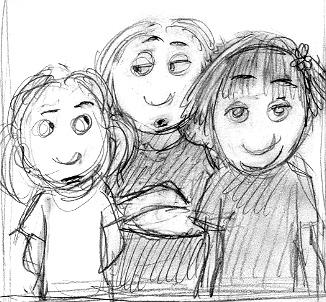Posts in Category: Blogue
Négligence
Pour l’amour il y a aimer, il manque un verbe pour l’amitié.
Tête-à-tête en différé
En quittant la maison ce midi je t’ai cueilli, en pensée, trèfle rose, chicorée et carotte sauvage. Un léger bouquet, dentelle de fin d’été. À la terrasse du café, il me prend l’envie de t’écrire. Dépose s’il te plaît cette gerbe sur la table où tu boiras un thé, cruelle amitié en différé.
Septembre est doux comme juillet, rémission avant le givre et les intérieurs. Les érables rougissent franchement. La ville est belle, les gens sourient…
Mon humeur est un camaïeu. Je nage dans les bleus de mes pastels, bleu sur le tablier, bleu sur les doigts, bleu sur les joues.
L’ange qui se reposait sur mon épaule, posé là comme un oiseau, me sourit gentiment ces temps-ci. Je réalise des images qui accompagneront, en grand format dans un musée, les âmes disparues.
Café au bord du fleuve (pastel gras)
Le grand cerf-volant
J’ai fabriqué un cerf-volant. Vingt ans durant.
J’ai cherché, déniché, inventé les matériaux les plus légers, pour que la brise le porte, qu’il puisse voyager.
J’ai croisé les plus souples roseaux, couché les plus fins papiers, rouges et orangés.
J’ai filé et noué les ficelles, j’ai bouclé bien serré les rubans bleus et dorés…
Ce matin, le matin des vingt ans, je suis sortie, je l’ai lâché. Le vent sitôt l’a emporté, s’y est engouffré, gonflant ses franges, allumant ses couleurs, et je l’ai vu danser.
Nit Màgica
Nit Màgica, Xarxa Teatre
Théatre pyrotechnique espagnol
Au cœur du festival d’été, il règne à la Place D’Youville une atmosphère d’incendie majeur. La rue Saint-Jean est incandescente. Pendant que les odeurs soufrées de poudre nous prennent à la gorge, un opaque nuage rouge et lumineux nous aveugle en éclaboussant la vieille pierre des façades et la foule dense, comme si l’enfer y faisait subitement éruption. C’est Xarxa Teatre qui remonte la rue au son d’une musique moyenâgeuse tonitruante.
Dans leurs vastes tuniques brunes à capuchon, grossier cordon noué à la taille, des moines joyeux et sautillants, nous pétaradent un train d’enfer sur leurs tambours, sur leurs caisses claires et dans leurs bombardes retentissantes. Ils sont poursuivis par des diablotins féroces et tournoyants, cachés sous des cagoules rappelant le KKK, armés de pétards, de cornes de taureaux et de lances crachant d’immenses jets de feux d’artifice. Ils en arrosent énergiquement l’espace, les pavés et les badauds qui, terrifiés mais curieux, se massent derrière une rangées de vrais pompiers.
La foule pétrifiée jubile de bonheur tout au long du lent et singulier cortège qui, après avoir grimpé sur les fortifications, s’installe sur la porte de la vieille ville pour y allumer des jeux pyrotechniques époustouflants. Une multitude de petits engins vrillent dans tous les sens et s’allument les uns les autres en éclaboussant à la ronde leurs étincelles de feu, au son démesuré de la musique des troubadours déments… Comme si Dieu et Diable réglaient leurs comptes.
Vu de chez Marie nous sommes aux premières loges et hurlons d’une joie toute enfantine. Difficile de résister à cette folie.
Chronique caniculaire
Chronique caniculaire
Je suis chez Marie pour la nuit. Son appartement est logé dans la mansarde, sous les combles d’un des plus vieux quartier d’Amérique. Le bâtiment imposant, muré de quatre pieds de pierre couchée, regarde vers l’ouest: navire accosté, pétrifié depuis des siècles, mais ardent, pointant imperturbablement au près serré dans le vent dominant.
Sur bâbord, boîte à fleurs au bastingage, vue en gros plan sur un pan de l’enceinte fortifiée qui encercle le Vieux-Québec en zigzagant: serpent de pierres grises, bastions, passerelles, courtines, poternes, pointes d’éperon… Plus haut, plus loin, le regard réussit à s’évader par-delà le rempart de grès, par-delà ses talus, ses meurtrières, les fers de lance de ses balustrades, par-dessus les ormes anciens, et à gagner le méli-mélo architectural de la ville. Notre vision médiévale se jette alors sur la Place D’Youville pavée de granit. S’y côtoient avec grâce le béton rose fenêtré de la banque, l’Art Déco du Palais Montcalm, sa pierre de taille grise et austère, et l’éclectisme du somptueux Théâtre Capitole, sa façade en quart-de-rond et son toit mansardé d’ardoise rouge. Puis, de loin en loin vers le sud, en vol d’oiseau au-dessus du moderne et du victorien, on mêle la France à l’Angleterre, on croise Gaspard Chaussegros de Léry et Eugène-Étienne Taché jusqu’au Second Empire de l’Hôtel du Parlement, ses sculptures en relief, ses armoiries, ses pavillons d’angles et sa tour Jacques-Cartier où flotte notre drapeau fleurdelisé.
À la poupe, fenêtre sur cour, tourbillon et brouhaha des terrasses enchevêtrées dans l’escarpement D’Auteuil. Chassés croisés d’escaliers tricotés serrés. Rumeur des jardins repliés sur eux-mêmes, débordants de végétation tropicale et de parfums luxuriants tapis dans la fraîcheur de l’ombre. Vase clos de petits bonheurs tranquilles. Secrets bien cachés, jalousement gardés, enchâssés au cœur des îlots de pierre, derrière les façades grises et brûlantes.
Sur tribord, fenêtre vers le nord. Comme à cloche-pied, le regard sautille à travers le Parc de l’Artillerie, ses lilas fleuris, ses casernes de brique rouge et leurs toits de cuivre vert-de-grisés, pour enjamber finalement la redoute Dauphine et tomber dans le vide. Un grand plongeon vers la ville basse, un survol plané de la vallée, jusqu’à l’horizon, jusqu’où le soleil disparaît, se heurtant aux contreforts bleutés des Laurentides dans un flamboyant crépuscule orangé.
La nuit
La ville haute s’engourdit peu à peu. Accalmie. Son bourdonnement s’assourdit en même temps que s’installent les lueurs nocturnes de l’éclairage citadin. Je suis étendue paisiblement sur le parquet du quatrième. Aussi bien que des grand’voiles, les fenêtres béantes capturent pour moi la brise légère et tiède de cette nuit torride. Dormir sur le pont supérieur du gaillard avant, à la belle-étoile. Je dors d’un sommeil doux, bercée par le roulis de la ville ralentie.
Puis, imperceptiblement, l’aube moite glisse sa lueur grise à l’intérieur, frôlant les objets familiers qui reprennent paresseusement leurs formes et leurs couleurs. Au loin, un carillon de cloches annonce dimanche. Je distingue, qui se rapproche, le cliquetis des premiers chevaux; le pas et le trot des bêtes dociles, percussions rythmées de bois creux, claquent en cadence sur les pavés durs et polis. Accompagnés du tintement de leurs grelots et des grincements de leurs attelages, ils passeront bientôt sous la fenêtre en petit concert chambranlant, prélude au jour qui se lève. Puis les percherons disparaîtront au sommet de la côte. Sachant par cœur l’itinéraire mille fois parcouru, ils mèneront seuls leur attirail, les cochers dormant encore mollement sur des rênes lâches.
Les livreurs arpentent les étroites ruelles depuis déjà un moment. Parfois retentit un klaxon, ou s’élève la voix impérative d’un homme anxieux de distribuer son chargement avant la cohue de la matinée. Viennent ensuite, dans l’ordre quotidien des choses, les pas des hommes, les pas des passants. Pas traînés, en pantoufles, des voisins vers la boulangerie et l’odeur du pain frais. Pas rebondis des sportifs qui battent le trottoir avant la chaleur accablante du midi.
Tantôt j’irai flâner Chez Temporel, grignoter le mémorable croissant au beurre emmenthal-confiture, siroter le meilleur allongé. Sans me presser, tout l’avant-midi. Pendant qu’une chape de plomb opaque s’installera, encore aujourd’hui, sur la vieille ville.
«Les voluptés du nonchaloir» dans la canicule de juillet.
Canicule
En cette saison poisseuse, tout est chaud et collant. Parfums, senteurs, remugles. Journées croupies, bouillies ou à l’étuvée. Climat de jungle amazonienne, paradis des insectes suceurs, bonheur des oiseaux et des pelouses bien vertes.
Saison des hélices, de toutes les hélices, celles des frigos, celles des congélateurs, des climatiseurs, déshumidificateurs, ventilateurs… de toutes les formes de toutes les couleurs qui fonctionnent à plein régime: concerts de cliquetis, de grondements, de ronrons et de vibrations.
N’est-ce pas la seule saison paresseuse, de nonchalance, de flânage, de lenteur, de sieste et de temps à perdre…
Tout de suite après le crépuscule rose, j’ai suspendu mon hamac à tâtons dans la brume, avec l’espoir d’attraper la fraîcheur du soir. Peine perdue, me voilà attaquée de toutes parts, dans les petites zones les plus effrontées: le cou, l’aisselle, l’orteil, le genou, le nombril… et je n’ai pas dormi.
Mais j’ai rêvé de sable sec et chaud, d’un vent cuisant et d’une trempette dans les vagues glacées de l’océan.
Fraîcheur ce matin, grisaille cette semaine…
Décidément la saison n’est pas ordinaire!
Aller-retour à Tadoussac
À la descente du bateau, au bout de la route verte et bleue, nous nous sommes retrouvés, le temps et l’espace de vingt chansons, comme à vingt ans en plein village hippie. Pour son festival, la petite Tadoussac devient un grand rassemblement fraternel amical jeune et insouciant.
Cet été-là, Yves Desrosiers, fébrile et habité, y donnait vendredi devant une salle pleine et colorée son Volodia dramatique. Un brin sur rien, osseux, l’œil fou et le regard halluciné, il nous a offert, de sa voix ébréchée, de ses doigts fiévreux tiraillant la guitare, l’âme du dissident Vladimir Vissotsky. Âme toute nue, translucide, transie, volcanique. Âme russe exaltée, expirée, mise en abyme.
Poignant.
Sommes revenus puisqu’il le faut: fuite vers l’avant, élan sans fin, droit devant à la poursuite de la constellation du Lion… qui s’évanouit à la faveur des étoiles clinquantes de la ville. Le monde à l’envers…
Fusions municipales
J’étais jadis une carougeoise des champs.
Je suis depuis peu une haute-villoise à bec fin.
Chacun dans son patelin on peut rêver les uns aux autres.
Les appétissantes gardangeoises, riveloises, mariennes et malbéennes…
Les sérieux donaconiens, pèrepointois, pistolois et valcartistes…
Les mignons agapitois, amquiens, pocatois, bicois, escouminois…
Les insulaires compliqués isletains, isle-vertois, grosse-islois, coudrilois…
Les aristos boischatelois, château-richérois, fossambaugeois, new-richmondois…
Les classiques angelois, antoniens, apollinairois, augustiniens, nicolois et georgiens…
Mais je garde mes amours basse-vilain!
Sweet sixties, flower power, road trip…
Au beau milieu des restos pour touristes, en plein après-midi triste, je cherchais un refuge.
Sur la vitrine, écrit à la main: Chez José, cuisine de quartier. À travers la vitrine, éparpillés et dépareillés, quelques tables, quelques flâneurs. J’y suis entrée comme on entre dans un aquarium, à reculons. Espace réduit, comme un coffret. Parfum de coriandre fraîche. Au plafond, posters de vagues géantes et de surfeurs. «Ah, le Pacifique…», me dis-je. Poissons naïfs multicolores barbouillés à la grandeur des murs. Jeunes qui jasent d’emplois, d’appartements, de voyage. Musique de vacances…
Au menu: soupe-sandwich-café-viennoiserie. Un grand bol-piscine où toute la mer flottait, appétissante, dans ses coquillages. Petit pain comme on n’en trouve pas. Café, dont un seul justifie tout un après-midi. Qu’avais-je besoin de plus?…
– «Réconfortant!» dis-je au garçon. «Merci, sympa!», répondit-il candidement. «Toi-même!». pensai-je…
Qu’est-ce que j’aurais eu envie de monter illico dans mon vieux Westfalia et de m’élancer droit devant moi, cap au sud-ouest, de traverser le continent sans arrière-pensée, vers le soleil, vers l’océan, vers l’insouciance.
Il faisait soleil en sortant…
Vive la grande déferlante qui nous porte loin avec style!
Lieux communs
Ça se passait chez la vietnamienne. Lieu commun.
Comme pour l’éternité, étions-nous cinq ou quinze, Xuân nous servait fidèlement le won ton, les rouleaux et son sourire de Bouddha. Assis dos à la fenêtre, dos à la 18ième, dos à la ville, le dépaysement était tout de même un lamentable échec. Ni le faux lierre, ni les fausses lampes, pas même l’authentique musique ne parvenait à nous emmener bien loin de chez soi.
Certes il y avait les beignets…
J’étais là très bien servie. Comme le cheveu sur la soupe ou le loup dans la bergerie, j’étais faiseuse d’images parmi gens de lettre. Outsider de mon état depuis toujours, il m’était devenu au fil des ans beaucoup plus agréable d’évoluer chez les autres que chez mes semblables, étrangère en terre étrangère. C’était ma manière de voyager.
Tous plus ou moins artistes pourtant, tous plus ou moins travailleurs solitaires, nous nous y présentions la tête et les poches plutôt vides. C’était la condition très vague mais essentielle, je crois, à la réussite de la soirée. Ce qui nous réunissait n’était-il pas simplement le douloureux manque des éternels insatisfaits ou le vil pincement au coeur des extralucides. Comme il serait bon, pensions-nous probablement tous, de voler au-dessus de tout cela, ou tout au moins à la surface.
Zen. C’était ça le dépaysement.
Tapis au balcon (pastel gras)
Princesses au bois
Promenade du dimanche avec la princesse poilue.
Nous avons observé le bal de quelques rapaces diurnes en vol circulaire plané, puis salué de très près la famille des cerfs: une belle grande femelle inquiète, avec ses trois grands veaux étourdis…
En cherchant un ruisseau, nous sommes allées comme deux simples d’esprit nous prendre dans un dense boisé de ronces et d’aubépines. Les premières nous barraient les chevilles, les sciant au passage en nous bouffant les ergots, les secondes nous attrapaient littéralement en nous transperçant de milliers de dards superbement aiguisés. J’ai eu une petite pensée pour Jésus et la coiffe qu’on lui fit un certain vendredi, mais notre boisé était plutôt enchevêtré à la manière des rosiers du château de la Belle au bois dormant.
Nous nous en sommes finalement bien tirées sans le prince charmant, juste quelques bonnes égratignures, des tocs dans le poil et une petite faim…
Chronique zoologique-1
Jardin zoologique du Québec (1931-2006).
La fermeture d’un zoo. Bien embêtant de monter aux barricades, mais j’ai pu y faire la tournée des pensionnaires, dont voici quelques-uns des portraits.
En ma qualité d’oiseau bizarre, au nom des kangourous arboricoles, de l’ara hyacinthe, de l’ourse aveugle, du chameau qui pue et, surtout, de Sia, le vieux singe qui ne survivra pas au chambardement; au nom des arbres du boisé menacé; au nom des souvenirs «quatre saisons au zoo» gravées dans ma mémoire, dans celle de mes parents, dans celle de mes enfants… je vous invite à une visite posthume, croquée juste avant la fermeture du parc en 2006.
 À gauche, Toupie, la très vieille ourse d’Alaska
À gauche, Toupie, la très vieille ourse d’Alaska
Autres photos:
Les grognons grizzlys, Mary et Cody
Les ours polaires, trois pas devant, trois pas derrière
Sophie, la frondeuse chimpanzé
Andrei et Veneska, léopards de l’Amour
Disco, l’hypnotique dendrolague de Matschie
Gilligan, le harfang des neiges
Stewart, le grand-duc d’Europe
Maurice, l’excentrique pigeon Goura de Scheepmaker
Le calao rhinocéros, le cacatoès noir, le petit podarge gris
Le python malais, le porc-épic de l’Inde
Les lémurs catta et vari, les ardents suricates
Les joviales loutres cendrées d’Asie
Les bouquetins souverains, lamas et alpagas, siamangs, muntjacs, pingouins clowns, lézards à collerette…
Tous les volatiles, primates, félins, canins, cervidés, tous les renifleurs, grignoteurs, mâcheurs, cracheurs…
Bonne continuation!
Suite de la chronique zoologique ici.
Une autre chronique musique
J’ai ce dada de photographier les trésors artistiques cachés dans nos églises. C’était, jeudi dernier, le tour de la chapelle conventuelle des Soeurs de la Charité cachée derrière de banals édifices de béton, en contre-bas du Carré. D’aucuns auront aperçu au passage sa façade magnifique apparaître au bas de la côte D’Youville.
Cette chapelle est surprenante. Toute blanche et très étroite, elle se dresse bien haut sur ses quatre étages sagement cordés, quatre étages de balcons, de déambulatoires, de balustrades, de rampes, de paliers et d’escaliers, accrochés sur trois côtés généreusement fenestrés. En y pénétrant, on pense à ces bateaux à vapeur, illogiquement hauts, qui sillonnaient jadis le Mississipi, mais comme s’ils avaient été retournés le dedans vers le dehors, comme un gant, comme une chaussette, vous voyez? Enfin… Étourdissant!
Des petits sons enveloppants nous arrivent, tuuuuuuuu… vouuuuuuuuuu… bommmmmm… En se cassant le cou pour chercher des oiseaux tout en haut, on aperçoit le grand – vu l’étroitesse de l’endroit, mais en réalité petit – et joliment orné orgue Casavant: les claviers au troisième, les tuyaux, comme un large sourire doré dans une petite bouche, encastrés dans les troisième et quatrième jubés devant la coupole pleine de lumière. Mais… mais, sourire… édenté?!… Eh oui, il manque plein de tuyaux! En y regardant plus attentivement on distingue, encore plus haut au-dessus de tout ça, le réa principal d’un surprenant système de poulies, des câbles – de bateau, tiens – qui pendent ici et là, et une poignée d’hommes qui se battent, tout en nage, avec le fameux instrument – les frères Casavant eux-mêmes! dirais-je poétiquement: c’est le grand ménage de l’orgue.
Après quarante ans de loyaux services, c’est le grand toilettage, les ajustements, les rénovations de cette belle mécanique musicale. Les spécialistes entrent dans le ventre de la chose, grimpent, rampent, forcent, analysent, écoutent, cherchent la fuite, colmatent, testent… Démontent les systèmes compliqués de tuyauterie, de soufflerie, de volets, de tirants, de soupapes… Déracinent des pipes de toutes les grosseurs de toutes les longueurs, dont certaines n’en finissent pas, les font délicatement mais périlleusement voltiger d’un étage à l’autre, pour leur dénicher assez d’espace pour les coucher les unes à côté des autres, inoffensives, comme de grands arbres abattus. Les notes subtiles font place au grondement grossier et assourdissant des aspirateurs géants qui, on s’en doute bien, ne laisseront rien derrière, ne laisseront rien dedans. Trois semaines que ces hommes sont là à se démener autour du monstre, et au moins deux autres leur seront nécessaires pour en venir à bout. «Job de bras» et noble métier.
Un facteur d’orgue (ou organier) est un artisan spécialisé dans la fabrication, la maintenance, la réparation et la restauration d’orgues. Ce métier nécessite la maîtrise de nombreuses techniques, dont la menuiserie, la mécanique, le travail et le formage des métaux ainsi que des connaissances musicales et acoustiques très sérieuses ; il est répertorié parmi les métiers de l’artisanat d’art.
Photographie tirée du projet Art sacré, actes créateurs
Chronique musique
Comme regarder le chef cuisiner, le peintre peindre, le sculpteur sculpter, ce que j’aime de la musique, c’est être là quand elle est jouée. Être assez près pour la voir, la sentir, la toucher, la goûter, presque. Entendre les doigts glisser sur les cordes en un sifflement furtif… les touches, les clés, les marteaux frapper à petits pas feutrés… entendre, dans la vaste salle, cet écho particulier du grand piano à queue sur le plancher de bois franc. Je déguste les visages des musiciens, leurs regards complices, leur concentration, leurs sentiments, leur emportement parfois si fou, leurs respirations, leurs essoufflements, leur abandon.
Sinon c’est écouter les interprétations exceptionnelles. Celles livrées par des musiciens créateurs qui s’approprient les phrases des autres, investissent des pans d’histoire géniale, les revisitent, les réinventent, et nous les offrent dans leur propre langage, celui de l’art, celui de l’âme.
 J’ai retrouvé la vieille cassette audio, enregistrée jadis d’un encore plus ancien mais authentique vinyle. Une rareté : Barney Bigard et Claude Luter, clarinettistes de jazz, sur Swinging Clarinets (Vogue 767, épuisé). Tout ce son, toujours imprimé, miraculeusement intact et profond, sur un si mince et si fragile ruban…
J’ai retrouvé la vieille cassette audio, enregistrée jadis d’un encore plus ancien mais authentique vinyle. Une rareté : Barney Bigard et Claude Luter, clarinettistes de jazz, sur Swinging Clarinets (Vogue 767, épuisé). Tout ce son, toujours imprimé, miraculeusement intact et profond, sur un si mince et si fragile ruban…
De Struttin’ With Some Barbecue à Mood Indigo, entre le joyeux rag et le blues somptueux, les «deux faces» nous enfilent sans rémission duos et duels de clarinettes brillantes, tout aussi puissantes dans leurs énergies, que voluptueuses dans leurs langueurs. À côté de la basse, sage et ferme, de la caisse claire pétillante, du piano léger, audacieux, fougueux… les clarinettes nous hypnotisent de leurs rimes agilement chuchotées. On entend la brise, le vent, la tempête, se faufiler puis se ruer dans l’instrument de bois, on entend frémir les anches sur les lèvres expertes. Puis les clarinettes explosent, rayonnantes, du haut de leurs voix limpides et claironnantes. Voilà le sens du mot «jouer».